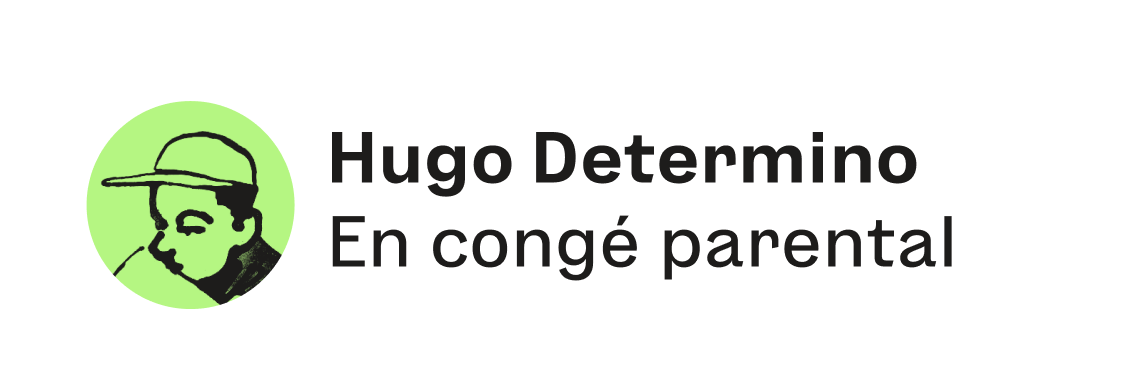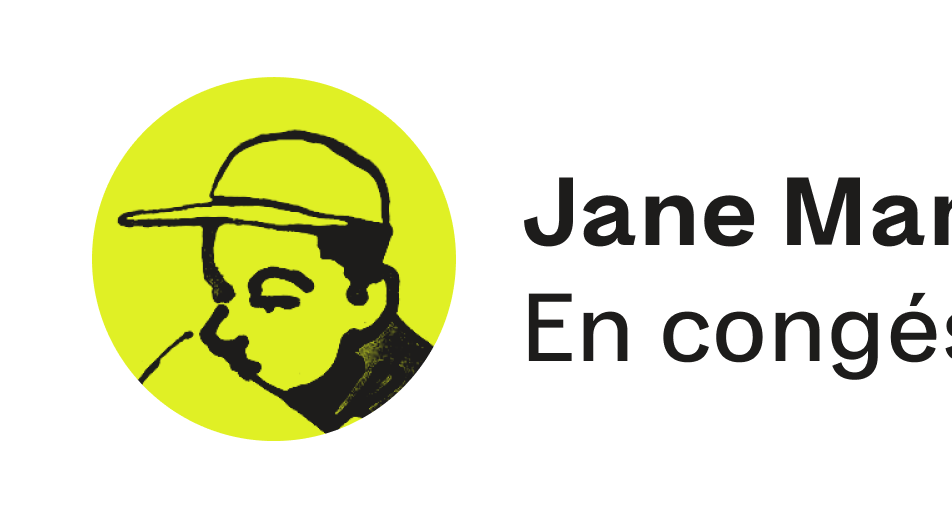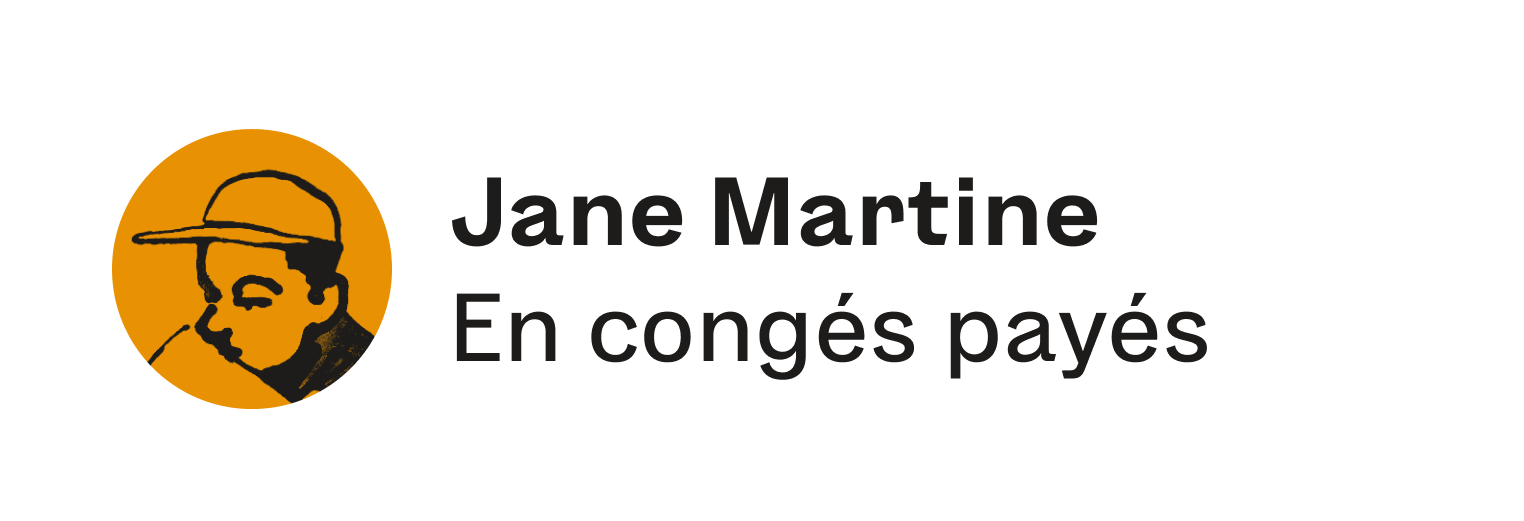Comment fonctionne la CFE en EURL ?
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt local dû par la plupart des sociétés, y compris les EURL. Calculée sur la valeur locative des locaux utilisés ou, à défaut, sur une base minimale liée au chiffre d’affaires, elle varie selon la commune d’implantation. Si toutes les EURL sont concernées dès la deuxième année d’activité, certaines bénéficient toutefois d’exonérations spécifiques. Cet article fait le point sur les règles essentielles de la CFE, son calcul et ses exceptions.
Quelles EURL doivent payer la CFE ?
En quoi consiste la CFE ?
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) représente un impôt local que toutes les entreprises françaises, dont les EURL, doivent acquitter lorsqu'elles exercent une activité régulière non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition.
La CFE constitue, avec la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), l'une des deux composantes de la Contribution Économique Territoriale (CET).
Bon à savoir
La CFE concerne toutes les sociétés, quel que soit leur statut juridique : sociétés, entreprises individuelles, micro-entrepreneurs.
Le principe est simple : toute activité professionnelle régulière exercée en France - commerciale, artisanale ou libérale - entraîne l’assujettissement à la CFE, peu importe le chiffre d’affaires ou les bénéfices, dès lors que l’entreprise dépasse les seuils d’exonération.
Les EURL qui débutent leur activité bénéficient d’une exonération automatique pour l’année de création. Cette exonération prend fin au 31 décembre de cette première année.
La CFE est fondée sur le principe que toute entreprise utilisant des locaux pour exercer son activité doit contribuer aux charges locales.
Deux cas de figures existent :
En cas de locaux commerciaux : la base d’imposition de la CFE correspond à la valeur locative cadastrale des biens immobiliers utilisés deux ans auparavant (année N-2) pour l’exploitation de l'activité.
En l’absence de local : L’administration applique une cotisation minimale déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé, soumise à un barème légal et adaptée par chaque commune.
Ainsi, même une EURL « sans bureau » — qui fonctionne entièrement à distance ou chez les clients — reste redevable de la CFE, sauf cas d’exonération spécifiques.
Chaque commune fixe son taux de CFE, ce qui entraîne d’importantes disparités quant au montant final à payer. Ce taux est ensuite multiplié par la base d’imposition (valeur locative du local ou base minimale selon le chiffre d'affaires).
Bon à savoir
Le paiement de la CFE doit s’effectuer de manière dématérialisée, avec un acompte (50%) et un solde, si le montant dépasse 3 000 €.
Exceptions : les EURL exonérées de CFE
Certaines EURL échappent à la CFE de manière temporaire ou définitive selon leur situation, leur activité ou leur implantation.
L’exonération la plus répandue concerne la première année d’activité de l’entreprise : toutes les EURL récemment créées bénéficient automatiquement d’une exonération jusqu’au 31 décembre de l’année de constitution.
En matière d’exonérations permanentes, la loi identifie plusieurs cas spécifiques :
Les artisans qui travaillent seuls, ou avec une main-d'œuvre très limitée et qui se rémunèrent principalement sur leur travail manuel, bénéficient parfois d’une exonération de plein droit.
D’autres professions peuvent également être totalement exonérées, telles que certaines activités éducatives, artistiques, ou les diffuseurs de presse selon des critères très précis.
Bon à savoir
La liste de ces exonérations figure dans le Code Général des Impôts, articles 1449 à 1466F. Par exemple, une EURL créée pour une activité d’enseignement peut prétendre à une exonération si l'activité remplit les conditions.
Certaines situations permettent à une EURL de réduire ou d’éviter totalement le paiement de la CFE :
Exonérations temporaires liées au territoire : Pour encourager l’implantation d’entreprises, la loi prévoit des exonérations dans certaines zones spécifiques comme les Zones Franches Urbaines (ZFU), les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), etc.
Exonérations sectorielles ou locales : Les communes ou intercommunalités peuvent voter des exonérations en fonction de l’activité exercée (professions artisanales ou de services de proximité). Par exemple : un artisan boulanger qui cuit et vend directement, un coiffeur salarié, etc. peuvent bénéficier d’une exonération, s’ils emploient moins de deux salariés.
Enfin, si l’EURL exerce à domicile ou chez les clients sans disposer de local professionnel, elle reste redevable d’une cotisation minimum, mais bénéficie dans certains cas d’une exonération ou d’un abattement.
Bon à savoir
Si le chiffre d’affaires annuel de l’EURL est inférieur ou égal à 5 000 €, elle bénéficie d’une exonération du paiement de la CFE.
Montants et calcul de la CFE
Comment est calculée la CFE des EURL ?
Le calcul de la CFE pour une EURL dépend principalement de l’utilisation de locaux professionnels et du chiffre d'affaires généré deux ans auparavant.
Si la société utilise un local dont elle a la jouissance (même à titre accessoire ou partagée), la base d’imposition correspond à la “valeur locative cadastrale” de ce bien, déterminée par l’administration fiscale.
Bon à savoir
Le montant de la CFE dépend du taux voté chaque année par la commune ou l’intercommunalité. Ainsi, deux EURL exerçant la même activité et avec le même statut peuvent payer des montants très différents selon leur lieu d’implantation.
Si l’EURL ne dispose d’aucun local, ou si la valeur locative du local reste inférieure à un minimum défini, la commune applique alors une cotisation minimale sur la base du chiffre d'affaires annuel de l’entreprise en N-2. Le barème de cette base minimum évolue par paliers de chiffre d'affaires, chaque tranche se voyant appliquer un plancher et un plafond adopté localement dans la fourchette autorisée par la loi.
Par exemple, en 2025 :
Pour un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 €, la base minimum oscille de 243 à 579 €.
Pour un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €, cette base minimale se situe entre 243 et 7 533 €.
Le montant final à payer correspond à la base multipliée par le taux d’imposition local, auquel peuvent parfois s’ajouter des frais annexes ou des prélèvements pour les chambres consulaires.
L’administration permet le paiement par voie totalement dématérialisée, soit via prélèvement mensuel, soit à échéance.
Si l’avis d’imposition atteint au moins 3 000 €, la société doit s’acquitter d’un acompte de 50% en juin, puis du solde en décembre.
Tableau des cotisations minimum de CFE en 2025
| Chiffre d’affaires / recettes (N-2) | Base minimum 2025 |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 10 000 € | 243 € à 579 € |
| 10 001 € à 32 600 € | 243 € à 1 158 € |
| 32 601 € à 100 000 € | 243 € à 2 433 € |
| 100 001 € à 250 000 € | 243 € à 4 056 € |
| 250 001 € à 500 000 € | 243 € à 5 793 € |
| Supérieur à 500 000 € | 243 € à 7 533 € |
Source : article 1647 D du code général des impôts
Les communes choisissent dans chaque tranche le montant exact de la base minimum applicable localement, ce qui explique les écarts marqués entre territoires. Pour chaque EURL, la combinaison de cette base minimum et du taux communal détermine la cotisation effective.
FAQ
Quelles sont les autres taxes d’une EURL ?
En dehors de la CFE, une EURL doit s’acquitter d’autres contributions fiscales. La plus connue est la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), qui concerne les EURL réalisant plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. La société doit la déclarer électroniquement via un mode EDI ou EFI. À cette imposition s’ajoutent la TVA, la taxe sur les salaires si l’entreprise n’est pas redevable de la TVA sur 90% de son chiffre d'affaires, et les prélèvements sociaux (cotisations sociales du gérant ou de l’associé unique d’EURL, contributions formation professionnelle). Les EURL qui exercent certaines activités doivent aussi acquitter la contribution à la Chambre de Métiers ou de Commerce et, localement, des taxes annexes peuvent s’ajouter, comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux professionnels.
Quelles différences entre une EURL avec un local ou sans local sur la CFE ?
La principale différence sur la CFE entre une EURL dotée d’un local professionnel et une EURL qui fonctionne sans local (par exemple à domicile, chez les clients ou exclusivement en télétravail) réside dans la méthode de calcul de la base d’imposition. L’EURL avec local paie la CFE sur la valeur locative cadastrale des biens immobiliers dédiés à son activité, c’est-à-dire une estimation administrative du loyer qu’un propriétaire pourrait percevoir pour la location de ces locaux.
En revanche, lorsqu’une EURL ne dispose d’aucun local identifiable pour son activité (cas fréquent pour les consultants, développeurs freelances, prestataires de services à domicile, etc.), elle n’échappe pas forcément à la CFE. Au contraire, elle doit s’acquitter d’une cotisation minimale dont le montant dépend de sa tranche de chiffre d'affaires selon un barème encadré au niveau national, mais adapté localement par la collectivité concernée. Dans ce contexte, la CFE reste due tant que le chiffre d'affaires excède 5 000 €.
Existe-t-il un dégrèvement partiel de CFE en cas de cessation d’activité de l’EURL ?
Lorsque l’EURL cesse son activité en cours d’année, elle peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un dégrèvement partiel de la CFE. Le fisc considère la CFE comme due pour l’ensemble de l’année si l’entreprise exerce au 1er janvier, mais dès lors que l’EURL interrompt définitivement son activité (dissolution, liquidation, radiation au RCS), elle peut demander le remboursement prorata temporis de la cotisation déjà acquittée pour la période postérieure à la cessation de l’activité. Cette règle vise à éviter que la société ne paie la CFE pour des périodes où elle n’exerce plus aucune activité.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, le représentant légal de l’EURL doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale, avec justification officielle de la cessation. En pratique, le dégrèvement est accordé pour chaque mois entier qui suit la cessation de l’activité, sur présentation des documents justificatifs (procès-verbal de dissolution, attestation de radiation, etc.). Cette démarche est incontournable pour éviter un paiement indû d’une CFE entière lorsqu’une EURL met fin à son activité avant le 31 décembre.
Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser
Ces articles pourraient aussi vous intéresser

Découvrez Jump
en 20 min
avec Léo.

Moi c'est Léo, je vous explique chaque jour le modèle Jump et ses avantages concrets en 20 minutes chrono. Entre 20 & 30 freelances posent leurs questions à chaque RDV. Rejoignez-nous pour tout comprendre !