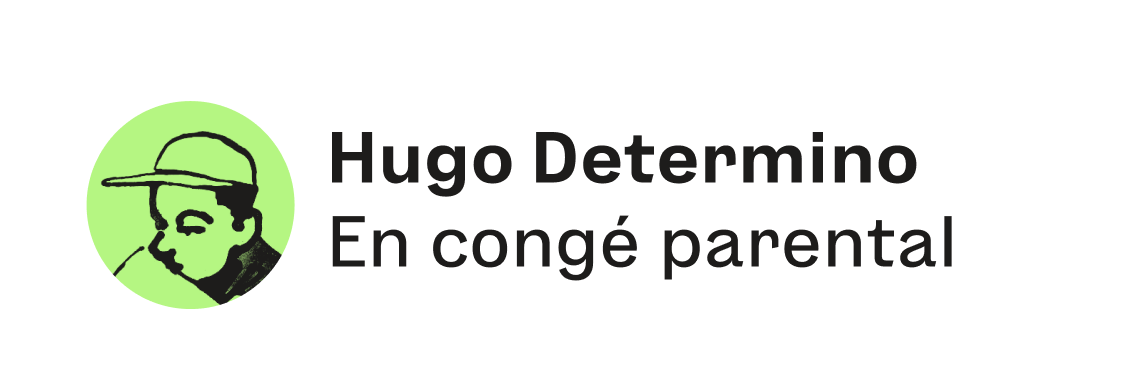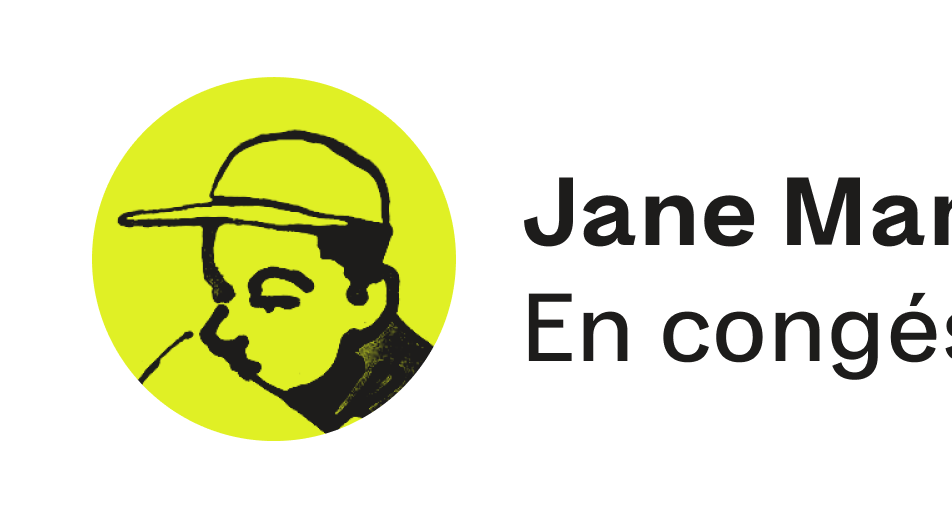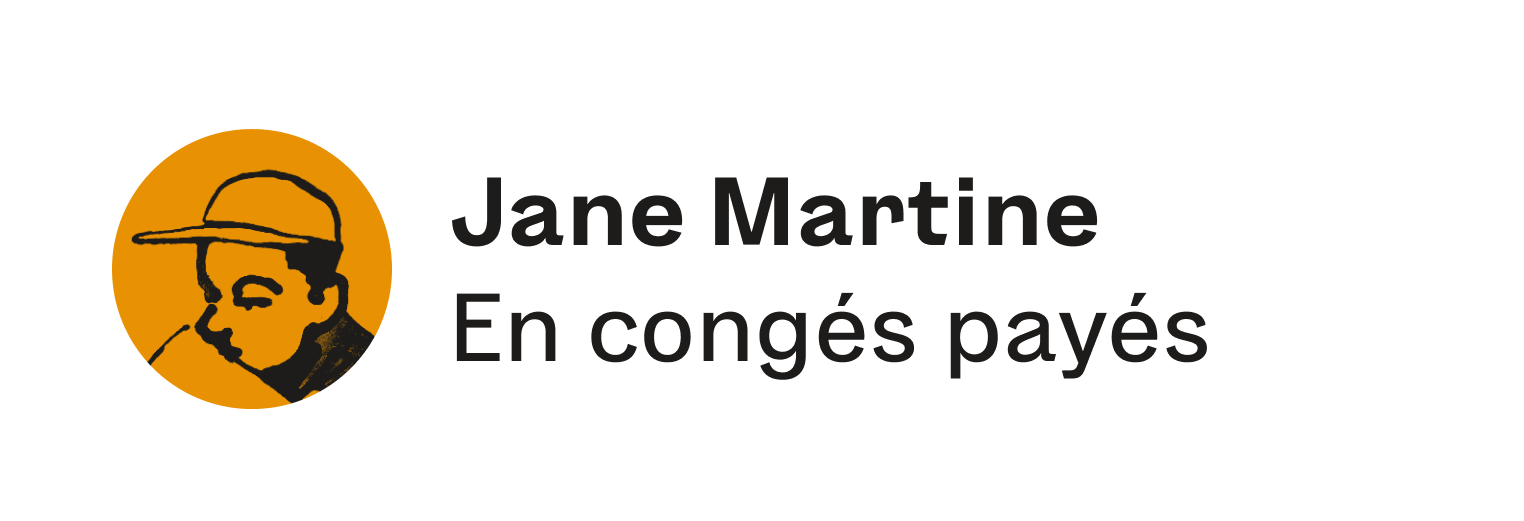Qu’est-ce que le régime de la déclaration contrôlée ?
Le régime de la déclaration contrôlée constitue un régime d’imposition et de déclaration des revenus applicable aux travailleurs indépendants - freelances - relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ce dernier repose sur la prise en compte du montant réel des recettes et des dépenses professionnelles engagées. Cela permet de déterminer un résultat fiscal précis sur la base de la comptabilité réelle de l’activité. Voici comment…
En quoi consiste le régime de la déclaration contrôlée ?
Le fonctionnement en bref
Le régime de la déclaration contrôlée s’adresse principalement aux professionnels qui perçoivent des revenus relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), tels que les freelances en prestations de services (ex. : graphiste, développeur web, rédacteurs web, chef de projet…).
À titre de comparaison, le régime micro-BNC (régime fiscal en micro-entreprise) propose une imposition forfaitaire basée sur un pourcentage des recettes. La déclaration contrôlée quant à elle impose les contribuables sur le bénéfice net réellement dégagé (différence entre les recettes et les charges effectivement engagées au cours de l’exercice).
Ce régime d’imposition devient obligatoire dès lors que les recettes annuelles dépassent 77 700 € hors taxes. Il est également possible de demander l’application de la déclaration contrôlée pour les contribuables qui restent en dessous de ce plafond et qui souhaitent bénéficier d’une comptabilité plus précise permettant une déduction du montant réel des frais professionnels.
Pour rappel, les charges déductibles englobent de nombreux postes de dépenses tels que :
les loyers concernant des locaux professionnels ;
les honoraires (ex. : honoraires d’un expert-comptable) ;
les amortissements (coût d’un bien réparti sur sa durée d’utilisation estimée avec par exemple un ordinateur, une voiture de fonction ou une machine…) ;
les frais de déplacement ou dépenses de matériel.
Ce régime requiert donc la tenue d’une comptabilité complète (livre-journal des recettes et des dépenses, registre des immobilisations et des amortissements). En contrepartie, cela permet une évaluation exacte des bénéfices, ouvrant la porte à davantage d’optimisation fiscale.
Chaque année, les freelances assujettis à ce régime doivent compléter la déclaration de résultat n°2035, accompagnée de ses annexes, en parallèle de la déclaration complémentaire de revenus n°2042 C Pro dans la catégorie du régime de la déclaration contrôlée.
Qui est concerné ?
Le régime de la déclaration contrôlée concerne tous les professionnels exerçant une activité non commerciale qui dépassent le seuil de 77 700 € hors taxes de recettes annuelles.
Sont donc visés la plupart des professions libérales, les consultants indépendants, certains experts, mais aussi les membres de sociétés de personnes fiscalement transparentes (comme les sociétés civiles de moyens, SCM, dont les associés exercent une activité BNC).
Certaines professions relèvent aussi obligatoirement de la déclaration contrôlée, quel que soit leur niveau de recettes :
les officiers publics et ministériels ;
les artistes et sportifs imposés sur une moyenne de revenus ;
les contribuables opérant dans la gestion d’instruments financiers à terme ;
les agents généraux d’assurances fiscalisés selon le régime des traitements et salaires ;
les professionnels qui exploitent tout ou partie de leur activité via un patrimoine fiduciaire.
À noter
Les micro-entrepreneurs en BNC (ex. : professions libérales) dont les revenus restent sous le seuil du régime micro-BNC peuvent opter volontairement pour la déclaration contrôlée, à condition de tenir une comptabilité exhaustive et de justifier du bénéfice net déclaré.
Les avantages et inconvénients du régime de la déclaration contrôlée
Opter pour le régime de la déclaration contrôlée présente plusieurs avantages :
la maîtrise intégrale de la base taxable grâce à la déduction réelle des charges professionnelles (un professionnel ayant de lourds frais de fonctionnement en retire un bénéfice net inférieur grâce à la déduction du montant réel de ces frais contrairement à un micro-entrepreneur bénéficiant d’un abattement forfaitaire ne dépassant pas 34 % du chiffre d’affaires en BNC) ;
en cas de déficit, ce régime autorise l’imputation des pertes sur le revenu global du foyer fiscal, ce qui abaisse potentiellement la charge d’impôt à payer.
Ce régime implique également des inconvénients à prendre en compte :
la gestion comptable se révèle plus complexe et chronophage, puisqu’il faut tenir un livre-journal, un registre des immobilisations et des amortissements, et conserver toutes les pièces justificatives (factures, notes de frais…).
ces exigences augmentent aussi le risque d’erreur ou d’insuffisance de preuves en cas de contrôle fiscal.
De nombreux titulaires d’activités BNC préfèrent ainsi rester sous le régime micro-BNC pour sa simplicité, surtout lorsque leurs charges sont limitées (montant inférieur au taux de l'abattement forfaitaire en micro-BNC) et stables.
Par ailleurs, le bénéfice d’un accompagnement par un expert-comptable s'avère quasi indispensable pour éviter les erreurs de déclaration, ce qui occasionne des frais supplémentaires que le professionnel doit intégrer dans son modèle économique.
Le choix entre déclaration contrôlée et micro-BNC s’effectue ainsi sur la base du montant des coûts professionnels par rapport au chiffre d’affaires et la capacité du professionnel à tenir une comptabilité complète (services d’un expert comptable généralement nécessaires).
Comparatif avec le micro-BNC :
| Critère | Déclaration contrôlée (BNC réel) | Micro-BNC |
|---|---|---|
| Seuil d’accès | > 77 700 € HT | ≤ 77 700 € HT |
| Imposition basée sur | Bénéfice net (recettes - charges) | Forfait (recettes avec abattement de 34 %) |
| Comptabilité | Complète et détaillée | Allégée (livre des recettes suffisant) |
| Déduction charges réelles | Oui | Non (abattement forfaitaire) |
| Imputation déficits | Oui, sur revenu global | Non |
| Complexité administrative | Élevée | Faible |
Toutes les obligations à respecter avec le régime de la déclaration contrôlée
Ce régime nécessite de respecter un certain nombre d’obligations comptables et fiscales, ce qui le distingue du régime simplifié micro-BNC.
Les obligations comptables
Les professionnels soumis à la déclaration contrôlée doivent tenir :
un livre-journal qui enregistre chronologiquement toutes les recettes encaissées et dépenses effectuées au titre de l’activité professionnelle durant l’exercice comptable. Ce document, qui peut être numérique, doit permettre d’identifier précisément la nature, la date et le montant de chaque opération, en appui des pièces justificatives adéquates.
un registre des immobilisations et des amortissements, qui regroupe tous les biens achetés pour une durée d’utilisation supérieure à un an et leur mode d’amortissement.
Ces registres sont obligatoires - y compris pour les micro-entrepreneurs qui opteraient pour la déclaration contrôlée. Ces outils permettent de justifier l’ensemble des charges déduites (frais professionnels, achats, loyer, assurances, amortissements, déplacements, fournitures, etc.).
La tenue de ces comptes s’apparente à celle prévue pour les sociétés au régime réel, garantissant ainsi une photographie fidèle de l’activité économique.
De même, ces pièces doivent être conservées pendant un délai légal de 10 ans, afin de répondre à toute demande d’information ou de contrôle de l’administration fiscale.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez exercer votre activité en toute autonomie sans devoir créer une entreprise et respecter toutes ces obligations comptables parfois complexes, vous pouvez opter pour le portage salarial. Si votre activité est éligible au portage, vous pouvez vous concentrer sur vos missions en déléguant toute la gestion administrative et comptable à la société de portage de votre choix.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à participer à l’une de nos présentations en ligne.
Les obligations fiscales
Sur le plan fiscal, le travailleur indépendant doit réaliser une double déclaration chaque année.
Ce dernier doit compléter :
la déclaration de résultats n°2035, où il détaille l’ensemble de ses recettes et dépenses, en y ajoutant les annexes adéquates selon son activité et la structure de son entreprise. Cette déclaration s’effectue de façon dématérialisée, au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année N+1 – par exemple, en mai 2026 pour les recettes et charges de 2025 ;
la déclaration complémentaire de revenus n°2042 C Pro, à la rubrique « régime de la déclaration contrôlée » sur laquelle le contribuable doit reporter son bénéfice net ou son déficit.
Cette double déclaration garantit une imposition exacte et évite tout problème de double imposition ou de mauvaise ventilation des revenus imposables.
Bon à savoir
L’adhésion à une association de gestion agréée (AGA) permet de bénéficier de contrôles de cohérence et fournit une attestation de conformité des comptes, ce qui sécurise la déclaration et réduit le risque d’erreur sur le plan fiscal.
Comment déclarer ses bénéfices : base de calcul et formulaire
La base de calcul résulte de la différence entre le total des recettes encaissées sur l’exercice et celui des charges justifiées et payées durant cette même période.
Sont considérées comme recettes :
toutes les sommes perçues dans le cadre professionnel ;
les honoraires ;
les remboursements de frais ;
les subventions ou produits financiers rattachés à l’activité.
Pour les charges, seule la réalité de la dépense (dépense effectivement payée), son rattachement à l’exercice comptable (dépense réalisée en 2025 déclarée pour l'exercice comptable de 2025) et sa justification comptable (ex. : une facture) comptent.
Les règles fiscales précisent parfois le mode de déduction de certaines catégories de charges (frais de repas, amortissements, location, assurances, formation, etc.). Il est donc essentiel de bien s’informer sur leur éligibilité et leur mode de traitement.
Le dépôt de la déclaration s’effectue en ligne, via l'espace professionnel sur impots.gouv.fr. Le formulaire principal pour la déclaration des bénéfices non commerciaux est le n°2035 ; il comprend une version simplifiée (2035-SD) pour les dossiers ne nécessitant pas d’annexes complexes.
Après avoir calculé le bénéfice net, le professionnel reporte ce montant sur la déclaration complémentaire n°2042 C Pro, où il est tenu d’indiquer la nature précise du régime fiscal (régime de la déclaration contrôlée).
Les erreurs de saisie, d’affectation ou d’omission peuvent entraîner des rappels de taxe, des pénalités, voire un contrôle fiscal complet. C’est pourquoi il est vivement conseillé de faire appel à un expert-comptable et d’utiliser un logiciel de comptabilité professionnel complet. Ce type d’outil propose différents niveaux d’automatisation, de suivi et d’intégration, pour un coût variable généralement compris entre 30 € et 80 € par mois.
Voici un tableau comparatif des solutions d’accompagnement pour la déclaration contrôlée :
| Solution | Avantages | Inconvénients | Fourchette de prix mensuelle |
|---|---|---|---|
| Comptable indépendant | Suivi personnalisé, conseils experts | Honoraires possiblement élevés, dépend de l’expertise et des prestations fournies | 80 – 150 € |
| Cabinet d’expertise | Sécurité, prise en charge complète | Moins personnalisé, coût élevé | 100 – 250 € |
| Logiciel de comptabilité | Gain de temps, coût raisonnable | Connaissances nécessaires des bases en comptabilité pour vérifier les données saisies | 30 – 80 € |
Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser
Ces articles pourraient aussi vous intéresser

Découvrez Jump
en 20 min
avec Léo.

Moi c'est Léo, je vous explique chaque jour le modèle Jump et ses avantages concrets en 20 minutes chrono. Entre 20 & 30 freelances posent leurs questions à chaque RDV. Rejoignez-nous pour tout comprendre !