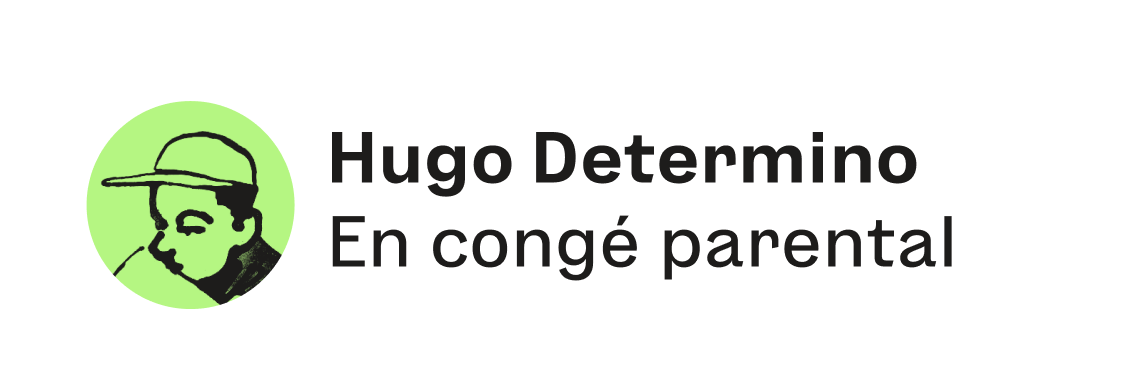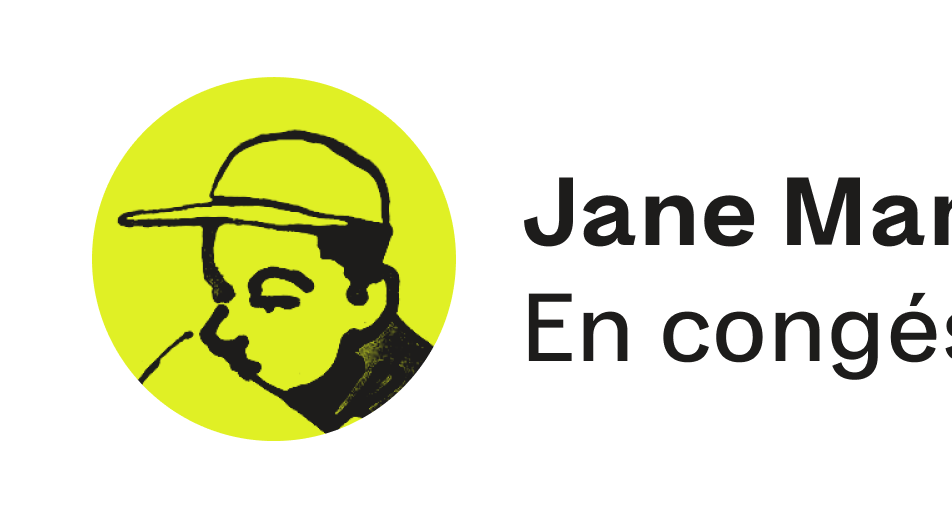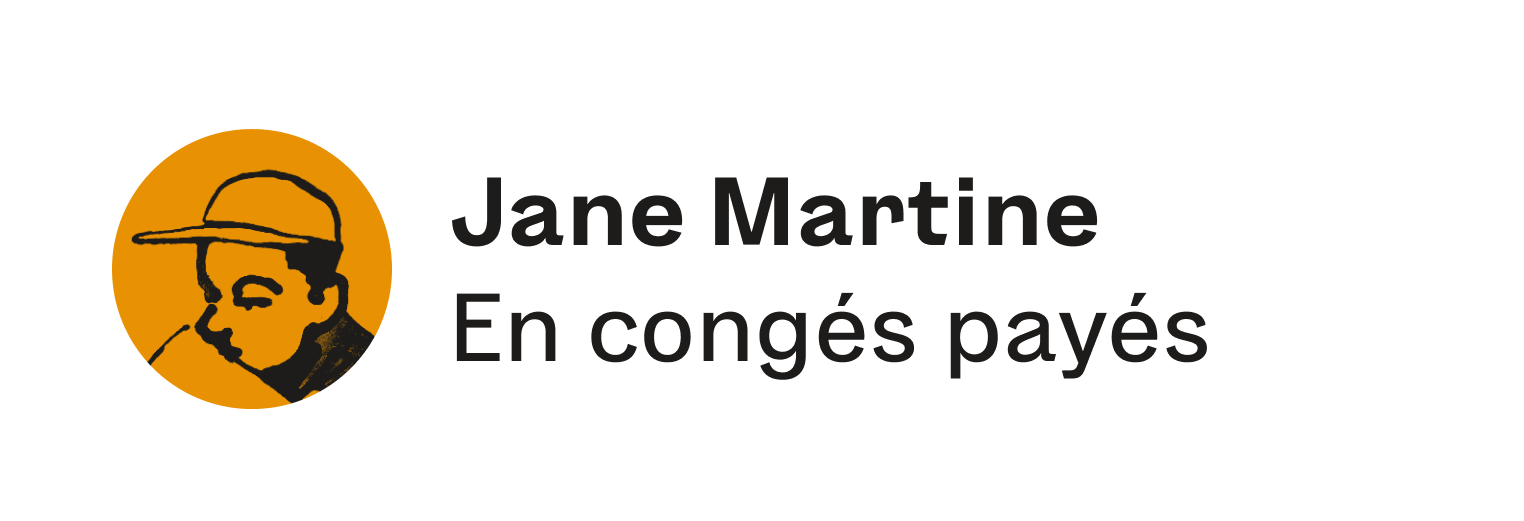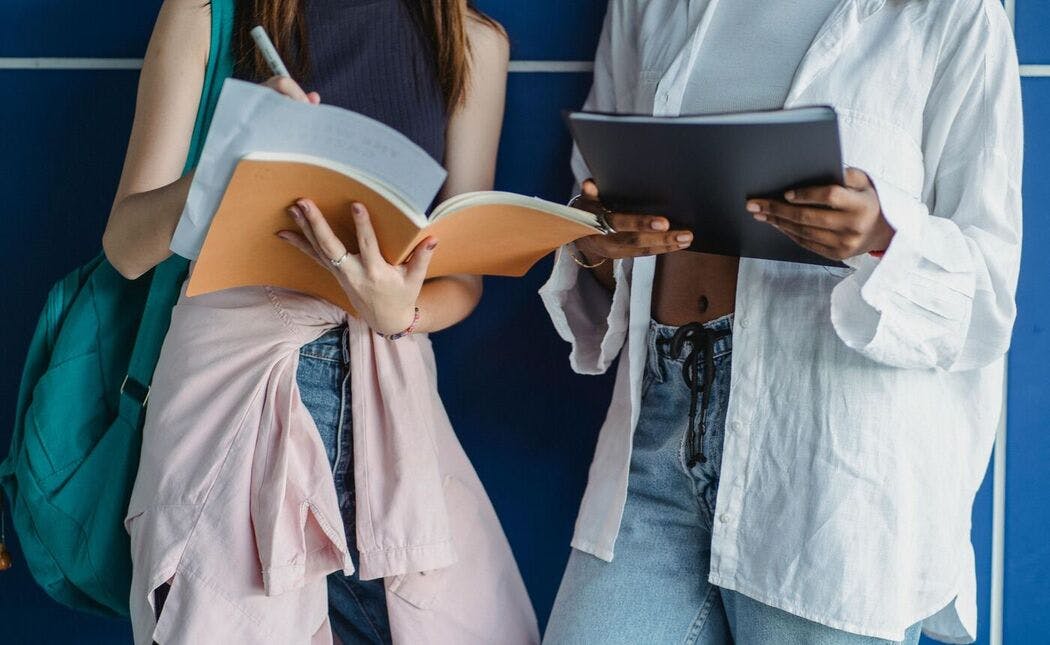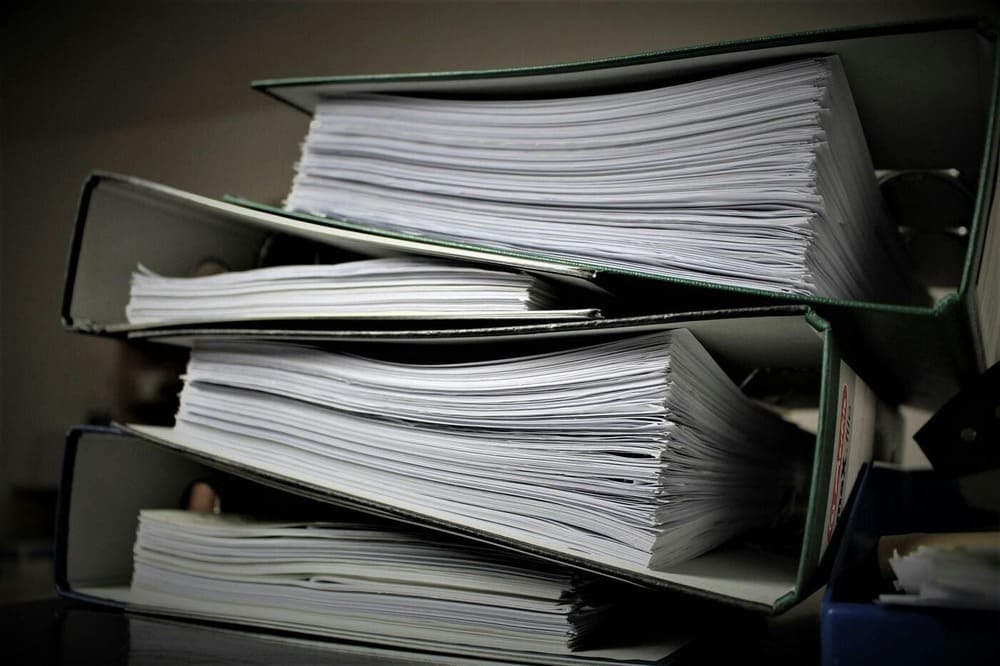Quelles alternatives à la micro-entreprise ?
Changer de statut devient une étape naturelle pour de nombreux auto-entrepreneurs dès lors que leur activité se développe ou qu’ils atteignent les plafonds de chiffre d’affaires. Si la micro-entreprise séduit par sa simplicité, elle montre rapidement ses limites en matière de fiscalité, de protection sociale et de crédibilité professionnelle. Pour aller plus loin, plusieurs solutions existent, qu’il s’agisse de créer une société unipersonnelle (type SASU, EURL), de rejoindre une structure collective ou d’opter pour une forme hybride comme le portage salarial. Chaque alternative répond à des besoins spécifiques selon le niveau de développement, le projet d’avenir et les attentes de l’entrepreneur. Ce guide passe en revue les principales options pour vous aider à faire un choix adapté à votre situation.
Changer son « statut » d’auto-entrepreneur : les alternatives
Pourquoi changer de statut ?
De nombreux auto-entrepreneurs envisagent de changer de statut après avoir expérimenté les limites inhérentes à ce régime.
Si le statut d’auto-entrepreneur séduit par sa simplicité administrative, la rapidité de création et la gestion allégée des obligations comptables et fiscales, ces avantages s’accompagnent aussi de contraintes importantes :
Les plafonds de chiffre d’affaires en micro-entreprise imposent une limite de croissance. En 2025, un auto-entrepreneur ne peut dépasser 77 700 € pour les prestations de service ou 188 700 € pour la vente de marchandises. Une fois ces seuils franchis, il doit obligatoirement changer de statut sous peine de perdre le bénéfice du régime simplifié.
Au-delà des plafonds, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire ses charges professionnelles réelles, ni amortir ses investissements, ce qui peut rapidement devenir un frein pour ceux qui investissent dans du matériel ou engagent des frais importants pour développer leur activité. Ce manque de souplesse fiscale pénalise la rentabilité à moyen terme, notamment pour les artisans ou consultants qui supportent des coûts fixes élevés. Par exemple, un photographe professionnel qui dépense 8 000 € pour du matériel haut de gamme (appareils, objectifs, éclairage) ne pourra pas amortir cet investissement ni le déduire de son chiffre d’affaires, contrairement à une société classique.
Enfin, l’absence de couverture chômage et la protection sociale moins avantageuse que celle d’un salarié incitent de nombreux indépendants à envisager des alternatives, notamment lorsqu’ils souhaitent sécuriser leur parcours professionnel ou embaucher.
Aperçu des autres statuts envisageables
Lorsque l’auto-entrepreneur atteint les limites de son régime, plusieurs alternatives s’offrent à lui, chacune présentant des spécificités juridiques, fiscales et sociales :
L’entreprise individuelle classique (EI) permet de rester dans une structure simple, mais offre la possibilité de déduire ses charges réelles et d’opter pour l’impôt sur les sociétés sous certaines conditions.
L’EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) constituent les formes sociétaires les plus courantes pour les entrepreneurs solos.
Le portage salarial séduit ceux qui veulent conserver une grande autonomie tout en bénéficiant de la protection sociale du salariat, notamment l’assurance chômage.
Enfin, la coopérative d’activité et d’emploi (CAE) offre un cadre collectif où l’entrepreneur devient « salarié-entrepreneur » de la coopérative, mutualisant ainsi les risques et les services administratifs.
Les sociétés unipersonnelles
L’EURL
L’EURL, ou Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, est une forme de société qui permet à une personne seule de créer une structure dotée de la personnalité morale. Elle fonctionne comme une SARL, mais avec un associé unique.
L’EURL est une structure attractive pour les entrepreneurs souhaitant allier sécurité juridique et souplesse fiscale :
Ce statut séduit les entrepreneurs qui souhaitent protéger leur patrimoine personnel, car la responsabilité se limite aux apports dans la société.
L’EURL offre également la possibilité de déduire l’ensemble des charges réelles (loyers, achats, amortissements, frais de déplacement, etc.), du chiffre d’affaires. Cela permet d'optimiser la fiscalité, surtout pour les activités nécessitant des investissements importants. Exemple : un artisan du bâtiment qui engage des dépenses pour un véhicule utilitaire, des machines-outils, ou la location d’un atelier, pourra déduire toutes ces charges de son résultat imposable.
L’EURL permet, lorsque l’associé unique est une personne physique, d’être soumise par défaut à l’impôt sur le revenu (IR), avec la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option offre une certaine souplesse pour adapter la fiscalité à la situation de l’entrepreneur.
Ce statut présente toutefois certaines contraintes :
La gestion administrative est plus lourde que celle d’une micro-entreprise : il faut tenir une comptabilité complète, déposer les comptes annuels au greffe et respecter des obligations juridiques strictes.
Les coûts de fonctionnement sont plus élevés qu’en micro-entreprise (frais d’expertise-comptable, frais de création, dépôt d’actes, etc).
Le gérant associé unique, s’il est une personne physique, relève du régime social des indépendants (SSI), ce qui implique des cotisations sociales calculées sur la rémunération et les bénéfices. Ce régime social peut être moins protecteur que celui des salariés, notamment en matière de retraite et de prévoyance.
L’EURL s’adresse donc aux entrepreneurs qui souhaitent structurer leur activité, préparer une croissance future, embaucher ou accueillir de nouveaux associés à terme. Elle offre une crédibilité supérieure à celle de l’auto-entreprise, mais demande une gestion plus rigoureuse et des coûts de fonctionnement plus élevés.
La SASU
La SASU, ou Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, est une société commerciale à associé unique qui séduit de plus en plus de créateurs d’entreprise pour sa flexibilité et sa modernité.
Voici les principaux avantages de la SASU qui en font une forme juridique attractive pour les entrepreneurs :
Contrairement à l’EURL, le président de la SASU, qu’il soit associé ou non, relève du régime général de la sécurité sociale dès lors qu’il est rémunéré. Cela lui permet de bénéficier d’une protection sociale équivalente à celle des salariés, hormis pour l’assurance chômage.
La SASU permet de fixer librement les règles de fonctionnement dans les statuts, ce qui facilite l’entrée de nouveaux associés ou la cession de parts dans la société.
La SASU est soumise par défaut à l’impôt sur les sociétés, mais il est possible d’opter pour l’impôt sur le revenu pendant les cinq premières années sous certaines conditions. Cette souplesse fiscale, combinée à la possibilité de déduire toutes les charges réelles, en fait une structure adaptée aux activités à fort potentiel de développement.
Cependant, la SASU présente aussi certains inconvénients à anticiper avant de choisir ce statut :
La gestion d’une SASU nécessite la tenue d’une comptabilité complète, la rédaction de statuts et le respect de formalités juridiques (assemblées, dépôt des comptes, etc.), ce qui engendre des frais de fonctionnement plus élevés que la micro-entreprise.
Le régime général est plus protecteur pour le président mais aussi plus coûteux que celui de l’EURL.
La SASU convient particulièrement aux consultants, freelances, créateurs de startups ou entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds ou s’associer facilement à l’avenir. Toutefois, le coût de la protection sociale du dirigeant est plus élevé que dans une EURL, et il n’a pas droit à l’assurance chômage sauf s’il souscrit à une assurance privée.
Le portage salarial et la coopérative d’activité et d’emploi
Le portage salarial
Le portage salarial représente une alternative hybride entre salariat et entrepreneuriat. Il permet à un professionnel indépendant de facturer ses prestations à des clients, tout en bénéficiant du statut de salarié auprès d’une société de portage. Cette société gère la facturation, les cotisations sociales, la paie et assure une protection sociale complète (maladie, retraite, prévoyance). Le porté conserve son autonomie dans la recherche de missions, la négociation des tarifs et l’organisation de son travail, mais il délègue toute la gestion administrative à la société de portage.
Bon à savoir
Le portage salarial n’est pas adapté aux activités réglementées.
Le principal avantage du portage salarial réside dans la protection sociale complète du statut de salarié, qui inclut notamment l’accès à l’assurance chômage, à une couverture santé optimale (sécurité sociale + mutuelle d’entreprise), à la retraite du régime général, ainsi qu’à la prévoyance et aux congés payés. Il convient particulièrement aux consultants, formateurs, experts ou cadres en transition professionnelle qui souhaitent tester une activité sans prendre de risques juridiques ou administratifs. En contrepartie, la société de portage prélève des frais de gestion, généralement entre 5 % et 15 % du chiffre d’affaires.
Bon à savoir
Faire appel à Jump pour votre portage salarial, c’est bénéficier de tous les avantages du statut de salarié tout en conservant votre autonomie. Contrairement aux sociétés de portage traditionnelles qui appliquent un pourcentage sur votre chiffre d’affaires, Jump propose un tarif fixe, transparent et très compétitif à partir de 99 € HT / mois, quelle que soit votre activité ou votre chiffre d’affaires.
Un choix particulièrement avantageux pour les freelances et indépendants qui souhaitent maximiser leurs revenus tout en sécurisant leur statut.
Le portage salarial s’impose donc comme une solution souple et sécurisante pour les freelances qui privilégient la simplicité et la protection sociale.
La coopérative d’activité et d’emploi
La coopérative d’activité et d’emploi (CAE) propose une alternative collective à l’entrepreneuriat individuel. En rejoignant une CAE, l’entrepreneur devient « salarié-entrepreneur » de la coopérative, qui porte juridiquement son activité, facture les clients, gère la comptabilité et reverse un salaire à l’entrepreneur en fonction de son chiffre d’affaires. Ce modèle mutualise les risques, les outils et les services (gestion, formation, accompagnement), tout en offrant la protection sociale du salariat.
La CAE séduit ceux qui souhaitent entreprendre sans être isolés, bénéficier d’un accompagnement et d’un réseau, ou tester une activité avant de créer leur propre structure. Elle favorise l’innovation sociale et la coopération entre entrepreneurs. La CAE prélève des frais de gestion (généralement autour de 5 à 15 % du chiffre d’affaires) et impose de respecter le cadre collectif, ce qui peut limiter l’autonomie de certains profils très indépendants.
Bon à savoir
Jump propose également une coopérative d’activité et d’emploi, ouverte à tous ceux qui souhaitent entreprendre dans un cadre collectif, sécurisé et accompagné.
FAQ
Quelles différences entre une entreprise individuelle et le régime de la micro-entreprise ?
L’entreprise individuelle (EI) et la micro-entreprise partagent un socle commun : l’entrepreneur exerce en son nom propre, sans création de personne morale distincte. Cependant, le régime de la micro-entreprise constitue une option fiscale et sociale simplifiée de l’entreprise individuelle. La micro-entreprise bénéficie de formalités de création ultra-simplifiées, d’une comptabilité allégée et d’un mode de calcul des cotisations sociales proportionnel au chiffre d’affaires encaissé, sans cotisations minimales en l’absence de revenus.
En revanche, l’entreprise individuelle classique permet de déduire les charges réelles (achats, loyers, amortissements, etc.), ce qui optimise la fiscalité pour les activités à forte dépense. Elle offre aussi la possibilité d’opter, sous conditions, pour l’impôt sur les sociétés, ce qui peut s’avérer avantageux pour certains profils. En matière de protection sociale, les deux régimes relèvent de la Sécurité sociale des indépendants. Cependant, en micro-entreprise, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d’affaires et sont dues dès le premier euro encaissé, même en l’absence de bénéfice. À l’inverse, en entreprise individuelle classique (régime réel), les cotisations sont basées sur le bénéfice réel, ce qui peut permettre de réduire la charge sociale en cas de faibles revenus ou de dépenses importantes.
Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser
Ces articles pourraient aussi vous intéresser

Découvrez Jump
en 20 min
avec Léo.

Moi c'est Léo, je vous explique chaque jour le modèle Jump et ses avantages concrets en 20 minutes chrono. Entre 20 & 30 freelances posent leurs questions à chaque RDV. Rejoignez-nous pour tout comprendre !