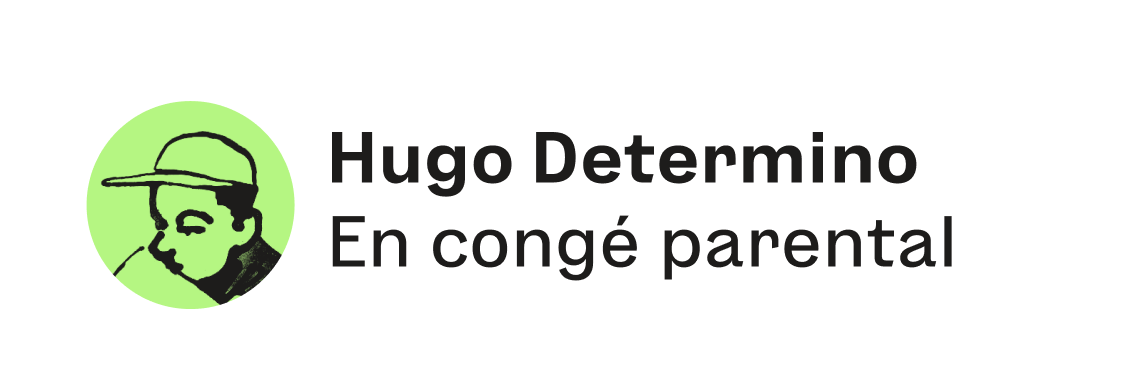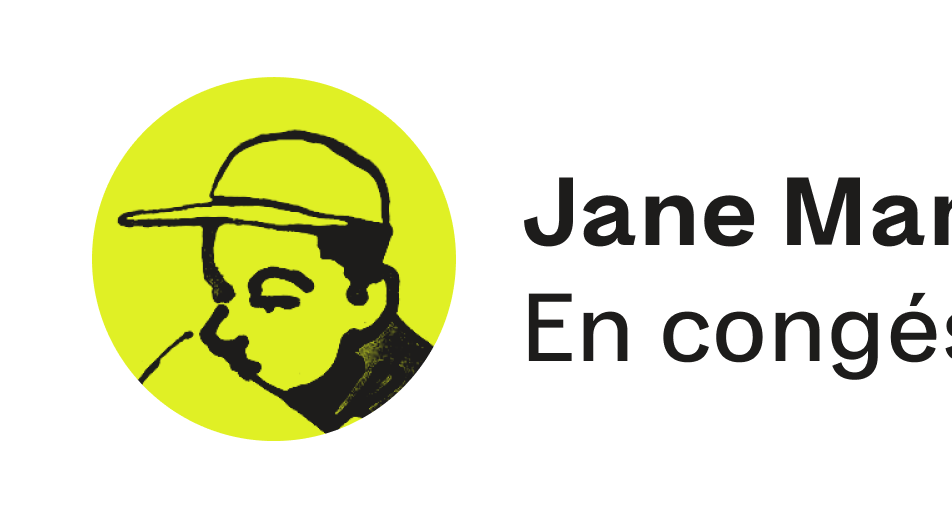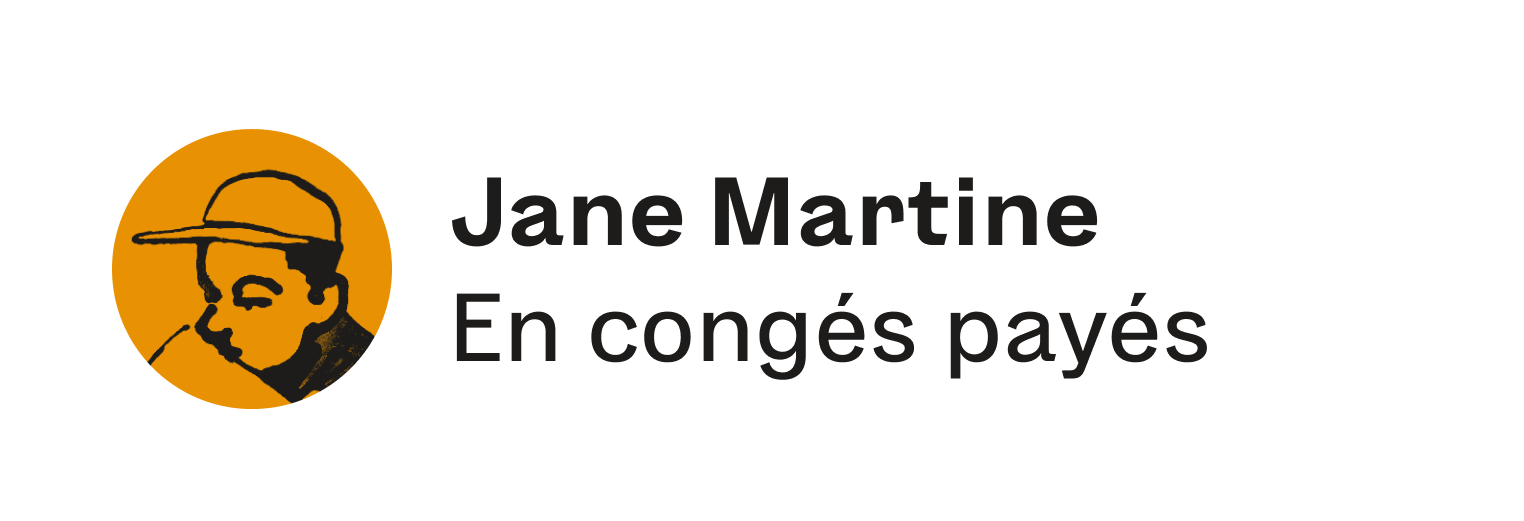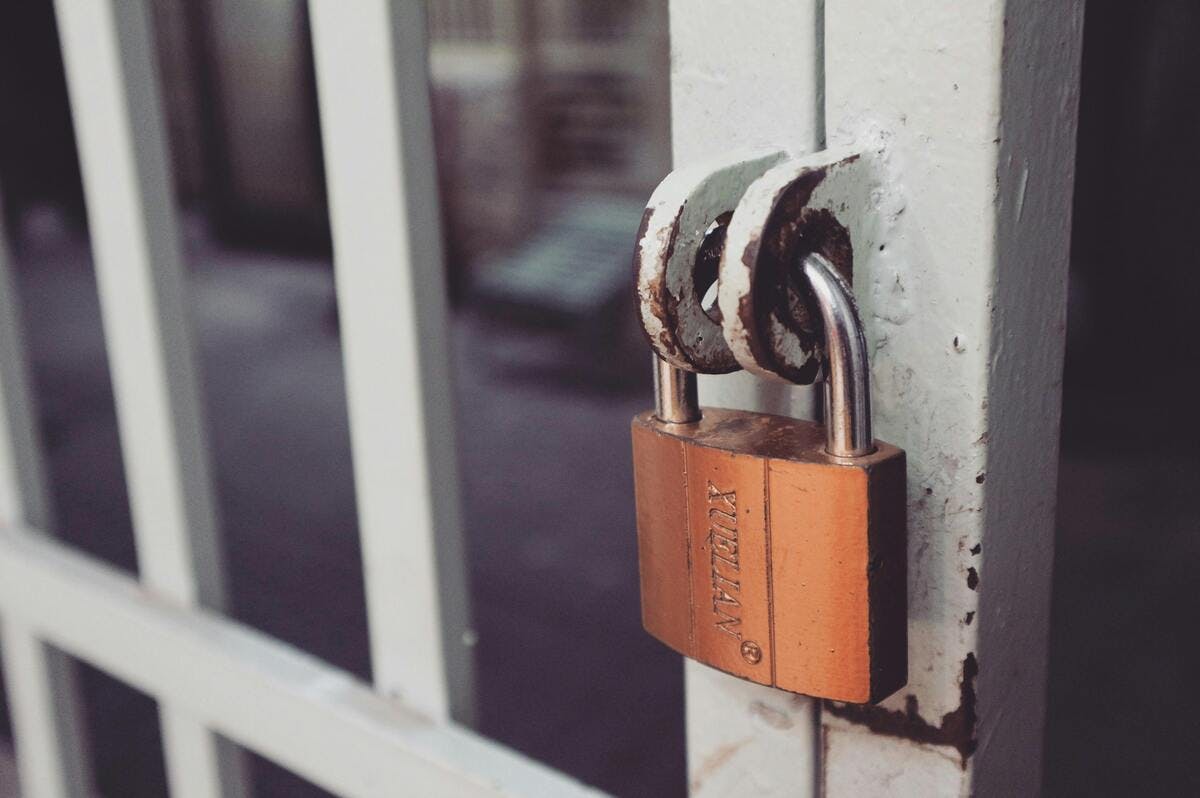Comment fonctionnent les apports en nature en SASU ?
L’apport en nature en SASU consiste à intégrer dans le capital social de la société un bien autre que de l’argent, comme un véhicule, un ordinateur, un fonds de commerce ou encore un brevet. Cette option permet à l’associé unique de valoriser ses actifs dès la création de la société, ou lors d'une augmentation de capital, sans mobiliser de trésorerie. L’opération doit respecter une procédure encadrée : elle implique une évaluation précise des biens apportés, la production de justificatifs, et parfois l’intervention d’un commissaire aux apports. Bien utilisé, ce mécanisme permet de structurer efficacement le capital social, tout en sécurisant juridiquement la démarche.
Apport en nature dans une SASU : intérêt et avantages
Qu’est-ce qu’un apport en nature ?
Un apport en nature dans une SASU désigne l’intégration au capital social de la société d’un bien autre qu’une somme d’argent.
Ce bien peut prendre la forme :
D’un meuble (matériel informatique, véhicule, mobilier, outillage),
D’un immeuble (local commercial, terrain),
D’un bien immatériel (logiciel, marque, brevet, fonds de commerce, fichier clients).
L’associé unique transfère la propriété ou la jouissance de ce bien à la société, qui l’intègre dans son patrimoine. Cette opération se distingue de l’apport en numéraire (argent) et de l’apport en industrie (connaissances ou compétences, qui ne participent pas à la formation du capital social). Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution du capital social de la SASU, c’est-à-dire que la société en devient immédiatement propriétaire.
Exemple : un entrepreneur crée une SASU pour lancer son activité de production audiovisuelle. Plutôt que d’apporter uniquement de l’argent, il décide d’apporter en nature une caméra professionnelle d’une valeur de 8 000 €, qu’il utilisait jusqu’ici en son nom propre. Ce matériel est évalué, intégré dans les statuts, et entre dans le capital de la société dès sa constitution.
Bon à savoir
Il est tout à fait possible de constituer le capital social d’une société uniquement avec des apports en nature, sans aucun apport en numéraire.
L’apport en nature joue un rôle fondamental dans la structuration du capital de la SASU. Il permet à l’associé unique de valoriser des actifs déjà en sa possession, tout en évitant de mobiliser de la trésorerie. Il s’agit d’une solution particulièrement intéressante pour les entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur activité sans liquidités importantes, mais qui disposent de biens valorisables (par exemple, un véhicule professionnel ou un logiciel développé en interne).
Pourquoi faire un apport en nature ?
Réaliser un apport en nature en SASU présente plusieurs avantages stratégiques et opérationnels. D’abord, il permet de renforcer les actifs de la société dès sa création ou lors d’une augmentation de capital, ce qui améliore sa crédibilité auprès des partenaires financiers, des clients et des fournisseurs. De plus, en apportant un bien plutôt que de l’argent, l’associé unique préserve sa trésorerie puisqu’il n’a pas besoin de débloquer de fonds immédiats.
Un autre atout non négligeable est lié à la fiscalité.En effet, les apports en nature effectués lors de la constitution de la SASU sont exonérés des droits d’enregistrement, à condition que l’associé s’engage à conserver les actions reçues pendant au moins trois ans. Cette mesure encourage l’apport de biens stratégiques comme un fonds de commerce, un brevet ou un local sans alourdir les frais initiaux.
Bon à savoir
Le droit d’enregistrement est un impôt perçu par l’État lors de certains actes juridiques, comme la cession de parts sociales, la vente d’un fonds de commerce ou encore les apports en société. Il est calculé sur la valeur des biens transmis et son taux varie selon la nature de l’opération.
Enfin, l’apport en nature permet d’adapter la structure du capital aux besoins réels de l’entreprise, en intégrant des actifs directement utiles à l’exploitation (machines, locaux, droits de propriété intellectuelle, etc.), sans recourir à un financement externe.
Comment réaliser un apport en nature en SASU ?
Les deux cas : la constitution d’une société et l’augmentation de capital
L’apport en nature en SASU intervient dans deux situations principales : lors de la constitution de la société ou dans le cadre d’une augmentation de capital. Dans les deux cas, la procédure reste similaire et nécessite une rigueur particulière pour garantir la sécurité juridique de l’opération.
Lors de la constitution, l’associé unique peut apporter tout ou partie du capital social sous forme de biens.
Ces apports doivent être décrits avec précision dans les statuts de la SASU :
Nature du bien,
Estimation de sa valeur,
Modalités de transfert,
Garanties contre l’éviction ou les vices cachés, etc.
Par exemple, un photographe créant une SASU peut apporter son matériel professionnel (appareil photo, ordinateurs, logiciels), évalué à 7 500 €. Ce montant comptera comme capital social et devra être mentionné dans les statuts.
Exemple de clause à mentionner dans les statuts
Article : Apports en nature
Madame X apporte à la société :
- un ordinateur portable de marque [Y], estimé à une valeur de [montant] euros ;
- un véhicule de marque marque [Z], estimé à une valeur de [montant] euros ;
TOTAL
Dans le cas d’une augmentation de capital, la société déjà existante accueille de nouveaux apports en nature, qui viennent s’ajouter au capital initial. Dans ce cas, l’associé (ou un nouvel apporteur) peut introduire de nouveaux biens dans la société.
Cette opération nécessite :
Une modification des statuts,
Une évaluation des biens apportés (parfois par un commissaire aux apports),
et une publication dans un journal d’annonces légales pour informer les tiers.
Les documents à fournir
La réalisation d’un apport en nature en SASU requiert la constitution d’un dossier documentaire solide. L’associé unique doit fournir les justificatifs attestant de la propriété du bien et de sa valeur. Ceux-ci seront annexés aux statuts de la société.
Parmi les documents exigés figurent :
Les factures ou devis d’achat, qui servent de base à l’évaluation du bien.
Les certificats de propriété (pour les biens immobiliers, véhicules, brevets, etc.).
Un traité d’apport ou une clause spécifique dans les statuts de la SASU, détaillant la nature du bien, sa valeur, les modalités de transfert et les garanties associées.
Un rapport du commissaire aux apports, lorsque sa nomination s’avère obligatoire (voir ci-après).
Les attestations ou expertises réalisées par un professionnel (expert-comptable, évaluateur agréé) pour les biens complexes ou de valeur significative.
Ces documents doivent être conservés dans les archives de la société afin de justifier de la réalité et de la valeur de l’apport en cas de contrôle ou de litige.
Quand faire appel à un commissaire aux apports ?
Le recours à un commissaire aux apports constitue une étape clé dans la sécurisation de l’apport en nature. Ce professionnel indépendant a pour mission d’évaluer la valeur des biens apportés et de vérifier qu’ils ne sont pas sous ou surévalués, afin de protéger les intérêts de la société et des tiers.
En SASU, la nomination d’un commissaire aux apports n’est pas systématique : elle dépend de la valeur des biens apportés et de la situation de l’associé unique.
Depuis la loi Sapin 2, l’associé unique peut se dispenser de nommer un commissaire aux apports si aucun bien n’a une valeur supérieure à 30 000 euros et si la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
L’associé doit alors retenir la valeur de revente (dite valeur vénale) du ou des biens apportés.
Dans tous les autres cas, la désignation d’un commissaire aux apports devient obligatoire. Ce dernier rédige un rapport, annexé aux statuts, qui détaille la méthode d’évaluation et atteste de la valeur retenue.
Exemple concret
Mme Martin crée une SASU avec un capital social de 10 000 euros. Elle apporte en nature un ordinateur professionnel estimé à 8 000 euros et un mobilier de bureau d’une valeur de 1 500 euros. La valeur totale des apports en nature est donc de 9 500 euros.
Dans ce cas, aucun bien n’a une valeur supérieure à 30 000 euros. Cependant, ici, la valeur totale des apports en nature (9 500 €) est supérieure à la moitié du capital social (5 000 €). Mme Martin devra donc obligatoirement nommer un commissaire aux apports pour sécuriser l’évaluation des biens apportés.
Apports en nature : quels droits sont conférés à la société ?
Tous les apports en nature ne confèrent pas les mêmes droits à la société. Selon la nature juridique de l’apport — propriété, jouissance, usufruit ou nue-propriété — les effets diffèrent en termes de contrôle, d’usage et de revenus.
Lorsque l’associé unique réalise un apport en nature à une SASU, il peut choisir le type de droit qu’il transmet à la société, ce qui influencera l’usage que celle-ci pourra en faire.
Apport en pleine propriété : la société devient pleinement propriétaire du bien à compter de son immatriculation. Le bien rejoint son patrimoine, ce qui lui donne un usage complet et permanent. C’est le cas le plus fréquent.
Apport en jouissance : le bien est simplement mis à disposition de la société pour une durée déterminée, sans transfert de propriété. L’apporteur en reste le propriétaire et récupère le bien à la fin de l’accord ou en cas de dissolution.
Apport en usufruit : la société reçoit le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus pendant une période déterminée (maximum 30 ans ou durée de vie de l’usufruitier). L’apporteur conserve la propriété.
Apport en nue-propriété : la société devient propriétaire du bien, mais ne peut ni l’utiliser ni en percevoir les fruits. Ces droits restent attachés à l’usufruitier, qui n’est pas la société.
FAQ
Comment évaluer un apport en nature en SASU ?
L’évaluation d’un apport en nature représente une étape cruciale, car elle conditionne la valeur du capital social et la répartition des droits sociaux. L’associé unique dispose de plusieurs méthodes pour évaluer les biens apportés. Il peut se référer à la valeur d’achat (factures, devis), aux prix du marché pour des biens similaires, ou solliciter un professionnel (expert-comptable, évaluateur agréé) pour les actifs complexes ou spécifiques. Pour les biens technologiques ou immatériels (logiciel, brevet), l’évaluation nécessite souvent une expertise indépendante, car leur valeur peut fluctuer en fonction de l’innovation, de la concurrence ou du potentiel commercial. La loi impose de retenir la valeur la plus proche de la réalité économique, afin d’éviter toute surévaluation qui pourrait nuire à la société ou à ses partenaires. En cas de doute, le commissaire aux apports tranche et fixe la valeur définitive, qui s’impose à l’associé unique et à la société.
Quelles preuves pour justifier un apport en nature en SASU ?
Pour justifier un apport en nature, l’associé unique doit fournir des preuves tangibles de la propriété et de la valeur du bien. Les justificatifs varient selon la nature de l’actif :
- Pour un bien mobilier (matériel, véhicule), il s’agit des factures d’achat, certificats d’immatriculation, attestations d’assurance.
- Pour un bien immobilier, l’acte de propriété ou le titre de cession s’impose.
- Pour un bien immatériel (marque, brevet, logiciel), il faut présenter les titres de propriété intellectuelle, les rapports d’expertise ou les contrats de cession.
Quel est le capital minimum en SASU ?
La législation française prévoit une grande souplesse pour la constitution du capital social minimum d’une SASU. Depuis la loi NRE de 2001, le capital minimum exigé s’élève à 1 euro symbolique. Cette règle s’applique aussi bien aux apports en numéraire qu’aux apports en nature. Toutefois, il est fortement recommandé de constituer un capital plus conséquent, en particulier lorsque l’activité nécessite des investissements importants ou que la société souhaite rassurer ses partenaires financiers.
En pratique, le montant du capital social doit refléter la réalité économique de l’entreprise et permettre de couvrir les besoins initiaux en équipements, locaux ou droits immatériels. Un capital trop faible peut nuire à la crédibilité de la société et limiter sa capacité d’emprunt ou de développement.
Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser
Ces articles pourraient aussi vous intéresser

Découvrez Jump
en 20 min
avec Léo.

Moi c'est Léo, je vous explique chaque jour le modèle Jump et ses avantages concrets en 20 minutes chrono. Entre 20 & 30 freelances posent leurs questions à chaque RDV. Rejoignez-nous pour tout comprendre !