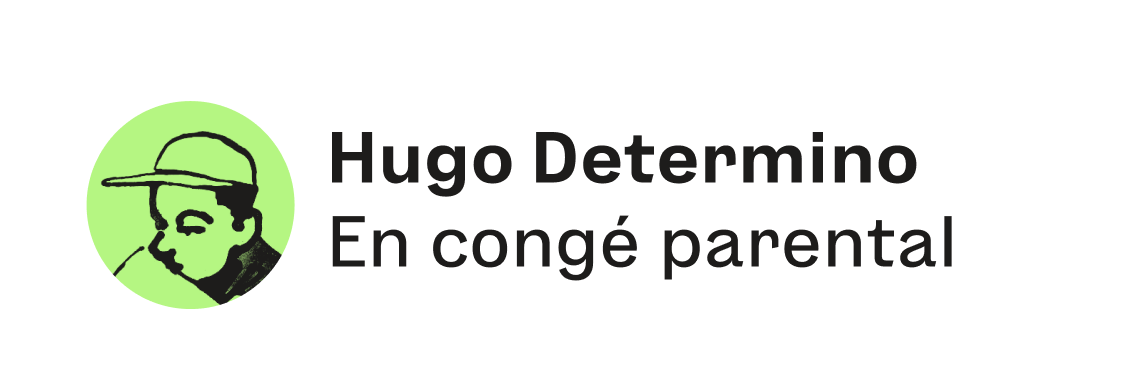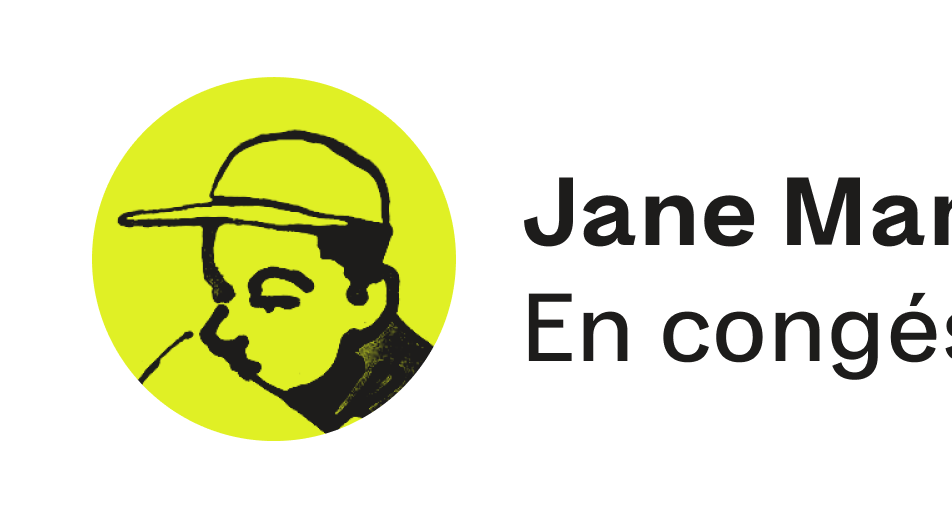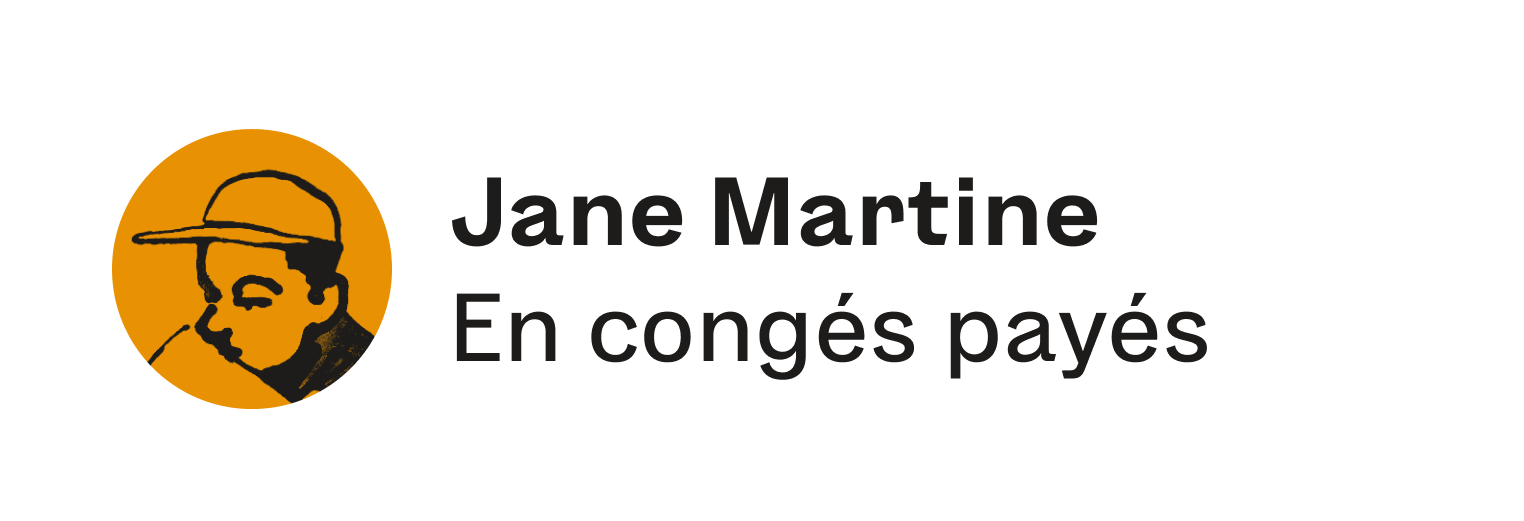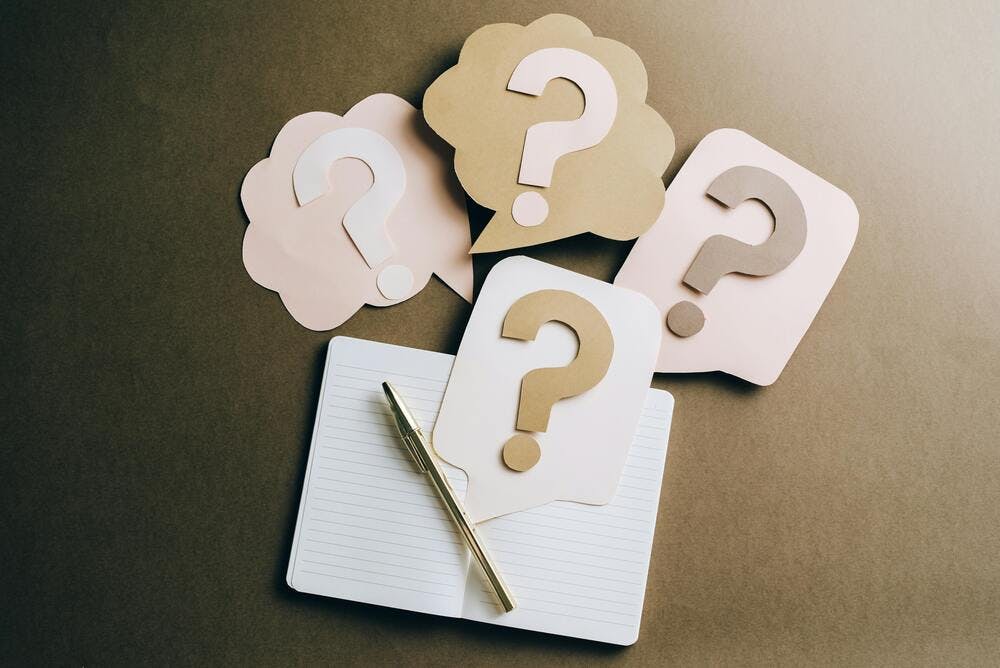Reconversion professionnelle et Auto-entrepreneur
Se reconvertir professionnellement en devenant auto-entrepreneur attire chaque année des milliers de Français en quête de liberté et de sens dans leur carrière. La simplicité administrative, les faibles charges sociales et la possibilité de tester une activité à moindre risque financier expliquent cet engouement.
Pour réussir sa transition professionnelle, il est conseillé d’analyser le marché dans le secteur concerné et formaliser un projet solide (étude de marché, business plan adapté). Le choix du statut juridique joue également un rôle central entre micro-entreprise, portage salarial ou coopérative par exemple. De nombreuses aides financières existent également pour sécuriser ce parcours : congé pour création d’entreprise, allocations chômage (ARE/ARCE)…
Pourquoi faire une reconversion professionnelle et devenir auto-entrepreneur ?
Les avantages
De plus en plus de Français choisissent l’auto-entrepreneuriat comme porte de sortie face à l’insatisfaction professionnelle. Selon l’Insee, l’année 2024 a connu une forte hausse de création de micro-entreprises (+7,3 %). Ce choix séduit particulièrement les actifs en reconversion qui cherchent autonomie, liberté d’organisation et faible barrière à l’entrée (plusieurs activités éligibles à la micro-entreprise, pas de capital social…).
Les atouts sont multiples :
L’auto-entrepreneur travaille à son rythme, fixe ses prix et choisit ses clients.
Les démarches administratives sont simplifiées : une déclaration en ligne suffit pour lancer son activité sur le guichet unique de formalités des entreprises.
Les charges sociales restent proportionnelles au chiffre d’affaires, ce qui réduit le risque financier (pas de cotisations sociales à payer sans chiffre d’affaires).
Le cumul avec un emploi salarié ou des allocations chômage est possible, ce qui sécurise la transition en ayant d’autres sources de revenus le temps de se constituer une clientèle en tant que micro-entrepreneur.
Le statut de la micro-entreprise permet souvent de tester un projet entrepreneurial sans mobiliser un capital important (pas de capital social en micro-entreprise, protection du patrimoine personnel).
Cette flexibilité attire autant les cadres en quête de sens que les professions intermédiaires en reconversion professionnelle dans une activité manuelle (artisans, métiers du bien-être, activités de services à domicile).
Les potentiels inconvénients
Ce statut a aussi ses limites. Tout d’abord, le chiffre d’affaires en auto-entreprise est plafonné à 188 700 € pour les activités commerciales et 77 700 € pour les prestations de services en 2025. Au-delà de ces plafonds, le micro-entrepreneur bascule automatiquement vers le régime réel de l’entreprise individuelle ou vers une autre structure de son choix si ce dernier anticipe cette transition (EURL, SASU…).
Si vous souhaitez dès à présent anticiper un changement de forme juridique de votre entreprise, voici notre comparateur de statuts en ligne Jump.
D’autres freins fréquents à la création d’une micro-entreprise sont à considérer :
L’absence d’allocation chômage en cas de cessation d’activité, sauf si vous cumulez des droits au chômage par le biais d’une autre activité (ex. : cumul auto-entreprise et activité salariée).
Une protection sociale moins étendue que celle des salariés : indemnités journalières plus faibles, pas d’assurance chômage, retraite moins avantageuse si revenus limités, pas de mutuelle d’entreprise.
Une charge de travail administrative et comptable parfois sous-estimée (déclarations, facturation, relances clients).
Un possible isolement pour les freelances qui travaillent à domicile : le passage de salarié à indépendant peut fragiliser socialement et psychologiquement.
Ces contraintes expliquent notamment que seulement 30 % en moyenne d’auto-entrepreneurs sont encore actifs sous ce statut après 5 ans d’activité (Insee).
Comment faire une reconversion professionnelle pour devenir auto-entrepreneur ?
Réaliser une étude de marché
Une reconversion réussie commence par le fait de valider son projet. L’étude de marché évalue la demande, la concurrence et le positionnement tarifaire. Elle doit répondre à trois questions : Y a-t-il une clientèle solvable ? Quelle est l’offre existante ? Quelle valeur ajoutée puis-je apporter ?
Exemples :
Un futur coach bien-être doit analyser le marché local (saturation ou nouveaux besoins liés au stress au travail).
Un freelance en rédaction web doit identifier la demande via des plateformes freelance (Malt, Upwork, Fiverr) et confronter ses tarifs à ceux du marché (TJM moyen : 372 € / jour selon le baromètre Malt 2025).
Un outil comme Google Trends ou l’observatoire des métiers de France Compétences permet également d’appuyer son analyse.
Établir un business plan
L’étape suivante consiste à structurer financièrement et stratégiquement son idée. Le business plan permet de chiffrer le projet, anticiper le seuil de rentabilité et convaincre d’éventuels financeurs (banques ou incubateurs).
Un bon business plan doit intégrer :
Une partie marché et concurrence.
Une prévision de chiffre d’affaires réaliste.
Des scénarios financiers sur 3 ans (charges, marge nette, seuil de rentabilité).
Un plan marketing (réseaux sociaux, prospection, site internet).
Même si l’auto-entreprise ne nécessite pas ce document pour démarrer une activité, ce dernier structure la reconversion professionnelle et rassure à la fois l’entrepreneur ainsi que ses investisseurs potentiels.
Choisir son statut juridique pour se lancer à son compte
Le plus simple : le portage salarial et la coopérative d’activités et d’emploi
Le portage salarial concerne les prestations intellectuelles (consulting, formation, informatique). L’indépendant - c’est-à-dire le salarié porté - signe un contrat de travail avec une société de portage (CDD ou CDI) qui se charge de la facturation ainsi que de la comptabilité concernant son activité. La société de portage en qualité d’employeur reverse un salaire au salarié porté, en prélevant environ 5 à 15 % de frais de gestion en portage, en contrepartie de la gestion administrative et comptable.
Bon à savoir
Chez Jump, nous appliquons des frais de gestion fixes (à partir de 99€ / HT par mois). De ce fait, vous ne payez pas plus de frais lorsque votre chiffre d’affaires augmente.
Les avantages pour le salarié porté sont de rester pleinement autonome dans la gestion de son activité (choix de ses tarifs et missions) avec une protection sociale en portage équivalente à celle d’un salarié. L’inconvénient : un coût du portage (frais de gestion, charges sociales, réserve financière) qui réduit la rémunération nette du freelance.
La coopérative d’activités et d’emploi (CAE) s’adresse quant à elle aux porteurs de projets multiples ou aux freelances qui veulent tester leur activité tout en bénéficiant d’un cadre collectif et d’un statut salarié-entrepreneur. C’est également une alternative aux freelances qui ne sont pas éligibles au portage salarial.
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible au portage salarial ? Faites le test avec notre outil Jump 👇
Pour aller plus loin
Vous êtes intéressé par le portage salarial ? Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ce type de contrat par rapport à l’auto-entreprise, venez poser toutes vos questions en ligne lors de l’une de nos présentations Jump.
Des démarches allégées : la micro-entreprise
Le régime micro-entrepreneur reste le plus accessible en termes de financement, de création et de gestion. Pas besoin de capital de départ, pas de comptabilité complexe (livre des recettes encaissées). Les charges sociales varient entre 12,3 % et 26,1 % du chiffre d’affaires, selon le type d’activité.
Comparatif des statuts les plus simples pour se lancer
| Statut | Protection sociale | Charges sociales | Simplicité administrative | Accès chômage | Limites |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro-entreprise | Couverture TNS (indépendant) | 12,3 à 26,1 % du CA | Très simple | Non | Plafonds de CA |
| Portage salarial | Régime salarié | environ 50 % du CA (net vs brut) | Simple, géré par société | Oui | 8–10 % frais de gestion |
| CAE | Régime salarié | environ 45 % du CA | Collectif et sécurisé | Oui | Engagement collectif |
Quelles sont les différentes aides envisageables ?
Le congé pour création d’entreprise
Un salarié en CDI peut demander un congé de création ou reprise d’entreprise pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Pendant ce congé, le salarié n’est pas rémunéré, mais conserve la garantie de retrouver son poste ou un poste équivalent à la fin du congé.
Conditions principales : avoir au moins 24 mois d’ancienneté (consécutifs ou non) dans l’entreprise et déposer la demande écrite deux mois avant la date souhaitée. L’employeur peut différer le congé de 6 mois maximum pour des raisons de maintien du bon fonctionnement de son entreprise.
Le principal intérêt de ce congé est de sécuriser ses revenus avec le maintien d’un emploi salarié le cas échéant tout en testant un projet entrepreneurial.
Les allocations chômage
Un demandeur d’emploi qui crée une auto-entreprise peut :
Soit continuer à percevoir l’ARE (allocation de retour à l’emploi) chaque mois, avec un ajustement en fonction des revenus déclarés de l’activité. Cela permet une certaine stabilité financière pendant les premiers mois.
Soit opter pour l’ARCE (Aide à la reprise ou création d’entreprise), qui transforme 60 % des droits restants en capital, versé en deux fois (la moitié au démarrage, le reste six mois plus tard si l’activité continue). Conditions : avoir obtenu l’ACRE pour bénéficier de l’ARCE, être inscrit comme demandeur d’emploi, et avoir validé un projet via France Travail.
Le passage à temps partiel
Les salariés en CDI peuvent demander à réduire leur temps de travail (temps partiel choisi) pour développer une activité entrepreneuriale. Cela permet de cumuler revenu salarié + développement progressif du projet entrepreneurial.
Les conditions à satisfaire sont les suivantes :
faire une demande deux mois à l’avance auprès de l’employeur ;
la demande peut être acceptée ou refusée pour nécessité de service.
Attention
Le passage au temps partiel génère mathématiquement une baisse de salaire proportionnelle au temps travaillé et nécessite une bonne organisation du temps de travail (partager son temps entre l’emploi salarié et son entreprise).
Le CPF
Le CPF constitue un levier pour financer une formation avant ou pendant un projet entrepreneurial. Il permet de suivre des formations certifiantes et qualifiantes inscrites au RNCP (ex : marketing digital, gestion d’entreprise, artisanat spécialisé, coaching professionnel).
Crédit disponible : 500 € par an (plafond 5 000 €).
Les indépendants cotisent également depuis 2018, mais peu utilisent encore cet outil. La reconversion entrepreneuriale peut nécessiter une montée en compétences.
Le FAF
Les FAF financent les formations des travailleurs non-salariés.
Chaque régime correspond à une branche professionnelle :
FIF-PL : professions libérales.
FAFCEA : artisans immatriculés à la Chambre de métiers.
AGEFICE : commerçants, dirigeants non-salariés du commerce et de l’industrie.
Montant possible : entre 500 € et 2 000 € de prise en charge par an selon la formation.
Avantage : permet de financer une formation utile à la reconversion, sans mobiliser son CPF.
Le PTP (projet de transition professionnelle)
Ce dispositif finance une formation longue certifiante pour changer de métier tout en restant salarié.
Voici les conditions pour en bénéficier :
le salarié doit justifier d’une certaine ancienneté (24 mois d’expérience, dont 12 dans l’entreprise actuelle) ;
le projet doit être validé par une commission, qui vérifie sa pertinence et sa viabilité.
Avantage : le salarié bénéficie d’une rémunération partielle, financée par l’organisme Transitions Pro, pendant toute la durée de la formation.
Le conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le CEP est un accompagnement gratuit et personnalisé permettant d’évaluer ses compétences professionnelles et préparer le cas échéant une reconversion. Des opérateurs habilités (APEC, Missions locales, Cap Emploi…) assurent ce service.
Atout important : ce dispositif permet d’être accompagné par différents conseillers dans un projet entrepreneurial et ainsi obtenir un pilotage stratégique facilement accessible (définir le projet, vérifier sa viabilité, trouver un financement…).
Le bilan de compétences
Le bilan de compétences offre une analyse approfondie du profil et identifie les atouts transférables dans un nouveau métier.
Il dure entre 20 et 24 heures (souvent sur 3 mois) et se déroule en trois phases :
analyse des besoins ;
investigation des compétences ;
validation d’un projet.
Le financement est généralement pris en charge par le CPF, les OPCO ou par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences.
Ce dispositif permet de vérifier la cohérence entre les envies d’entreprendre et la réalité du marché, évitant les “erreurs de reconversion”.
Aides financières : ACRE, ARCE, CAPE, NACRE
Voici les principales aides financières proposées à un micro-entrepreneur :
ACRE (Aide à la Création ou Reprise d’Entreprise) : exonération partielle (50%) de cotisations sociales pendant 12 mois. Accessible à tous les nouveaux créateurs sous condition (jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi indemnisés ou non…).
ARCE : déjà évoquée, capitalisation de l’ARE pour disposer d’un coup de pouce financier immédiat.
CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) : signature avec une structure qui héberge et accompagne le créateur dans son projet tout en lui offrant un statut sécurisant.
NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création ou Reprise d’Entreprise) : programme structuré en trois phases (aide au montage, structuration financière, appui post-création). Destiné particulièrement aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minimas sociaux. Depuis 2017, ce sont les régions qui gèrent ce dispositif.
Micro-crédit ADIE : permet aux demandeurs exclus du système bancaire classique d’obtenir un financement (jusqu’à 12 000 €) pour démarrer leur activité. Taux fixe à partir de 8,07 %.
Prêts d’honneur (Réseau Initiative France, Réseau Entreprendre) : prêts à taux zéro pouvant atteindre 50 000 €, attribués après présentation d’un dossier solide. Ils sont souvent un effet levier pour obtenir ensuite un prêt bancaire classique.
FAQ
Est-il possible de créer son entreprise en étant salarié ?
Oui, le cumul est possible sauf clause d’exclusivité dans le contrat. Le salarié doit prévenir son employeur et respecter la durée maximale du temps de travail.
Quelles sont les compétences pour se lancer en auto-entrepreneur ?
Il faut savoir prospecter, gérer sa trésorerie et les démarches administratives, communiquer et être autonome dans son organisation.
Quels sont les métiers qui recrutent pour une reconversion en micro-entreprise ?
Secteurs porteurs : numérique (rédaction web, graphisme, développement web, cybersécurité), bien-être, artisanat, services à la personne.
Comment se reconvertir sans perte de salaire ?
Il est possible de se reconvertir sans perte de salaire en cumulant les allocations chômage (ARE) avec ses revenus d’auto-entrepreneur ou avec un passage à temps partiel de son emploi salarié pour cumuler salaire et revenus en micro-entreprise.
Est-il possible de toucher le chômage avec sa micro-entreprise ?
Oui, mais uniquement si vous avez déjà ouvert des droits au chômage avant la création de l’auto-entreprise (droits au chômage obtenus avec un précédent emploi salarié) et en déclarant ses revenus mensuels (revenus pris en compte dans le calcul de l’ARE).
Quelles formations suivre pour créer son entreprise ?
Formations pratiques en gestion (CCI, CMA), compétences numériques et modules financés par le CPF (marketing digital, comptabilité).
Ces autres articles pourraient aussi vous intéresser
Ces articles pourraient aussi vous intéresser

Découvrez Jump
en 20 min
avec Léo.

Moi c'est Léo, je vous explique chaque jour le modèle Jump et ses avantages concrets en 20 minutes chrono. Entre 20 & 30 freelances posent leurs questions à chaque RDV. Rejoignez-nous pour tout comprendre !